Comme Glow ressuscitait les matchs de catch féminin télévisés des années 80 et The Deuce l′émergence du porno au début des années 70, Pose fait renaître le « voguing », expression de la culture des gays et transgenres latinos et afro-américains du milieu des années 80. Ces trois feuilletons mériteraient d’être regroupés sous le titre : « la Trilogie des Ghettos ».
Être un afro-américain ou latino, gay ou transgenre, à l′époque de Reagan, n’entre pas véritablement dans les critères de la « révolution conservatrice » qui a alors le vent en poupe. C′est être relégué à l’échelon le plus bas de la société américaine.
Lorsqu’on a pour point de départ la mise à la porte de sa famille, pour quotidien l’indignité et les coups, pour seules ressources la prostitution, le vol ou le trafic de drogue et pour destin le sida ou une mort violente, on mesure la désespérance constitutive de cette communauté. Quant à nous, au moment où ce petit monde se reconstitue sous nos yeux, où nous découvrons ces personnages et apprenons à les aimer, nous réalisons qu’ils sont tous morts depuis longtemps, qu’ils faisaient le tapin sur la jetée il y a plus de 30 ans et que si, depuis, le décor n’a sans doute guère changé, eux, en ont été effacés. Pose parle ainsi de fantômes, de fantômes formidablement vivants, beaux, joyeux, de fantômes tantôt rêveurs, tantôt ambitieux, drôles, arrogants, insupportables ou bouleversants.

Pour nous raconter leur histoire, Pose a le tact d′exprimer sans fard ni larmoiement l’angoisse endurée par tous ces exclus durant les années de propagation du Sida. Le paradigme s’énonce simplement : lorsque l’angoisse est insupportable, les désirs s’exacerbent pour la subvertir ou, pour le moins, la masquer. Question de dignité. Il s’agit de se dépenser à défaut d’accumuler ; chaque fête est une victoire, la mort repoussée d’autant, comme si les preuves de vitalité suffisaient à donner l’illusion de la vie. Mais, plus intimement, en ne l’avouant qu’à demi-mot, pointe sous les dehors extravagants le fantasme d’un ordinaire qui relève lui aussi, paradoxalement, de l’extraordinaire : l’aspiration à une vie amoureuse sereine, un Noël en famille, un logement à partager, quelque chose d’un ordre parfaitement conventionnel mais finalement rassurant : une famille, celle dont ils ont été autrefois éjectés, avec un père, une mère, des enfants, même si la mère a été garçon, autrefois. Autant dire l’impossible, en 1986.
Les choses seraient plus simples si ces garçons noirs étaient blancs et s’ils appartenaient aux classes sociales supérieures. Il leur suffirait alors de se servir. La démonstration est faite au travers de deux personnages, l′un cadre chez Trump, l′autre riche collectionneur d′art, qui entretiennent tous les deux secrètement et luxueusement des maîtresses transgenres. La vraie vulgarité est indéniablement de ce côté, du côté du pouvoir de l′argent et du cynisme qu′il autorise. À nouveau les spectateurs de 2018 s’y reconnaîtront, eux qui ont l’obscénité d’un Trump pour spectacle quotidien.
Malgré tout, malgré l’angoisse, malgré les conditions de vie difficiles, si Pose parvient à ménager à chacun de ses héros sa part d′ambition, de rêve, d′humour et de foi, c’est en brodant l′intime avec le politique, tant, dans cette communauté, le politique relève de l′intime. C′est aussi en cela que 30 ou 40 ans après les faits – si je puis dire -, Pose intervient dans le débat contemporain, comme l’on fait auparavant Transparent, The L World ou, dans un autre registre, The Handmaid’s tale.
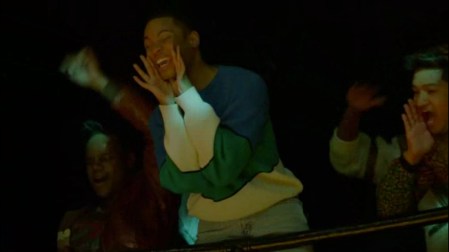
La série s′organise autour des compétitions festives d′alors : les « balls », manifestations par excellence du « voguing ». Les danseurs, regroupés en « houses » * et chaperonnés par une « mother », y défilent et dansent en pastichant les poses des mannequins des magazines de mode (notamment Vogue, d’où l’appellation « voguing »). Gestes codifiés – comme la « pose-mannequin »- costumes inouïs, thèmes imposés, maître de cérémonie sarcastique, jury façon télé-réalité, public survolté, les « balls » offrent la gloire d′un instant au sein du ghetto.

Les « vogueurs » imitent donc et détournent le spectacle stéréotypé de la haute couture, c′est à dire celui de la classe dominante. Leur clinquant est l’anti-clinquant d’un Trump. Pas de toilettes en or massif ni d’ascenseurs dorés mais des corps exaltés par des costumes détournés des soap-opera ou des vitrines de Gucci. Il faudrait revenir à Debord ou, peut-être mieux, à Jean Rouch pour mieux saisir ce qui est en jeu.
« Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images » affirmait Debord, ce qui est totalement vrai pour des vogueurs qui parodient la jet-set pour sans cesse réorganiser leur hiérarchie communautaire. Mais si je cite également Rouch, c′est pour son film de 1955, Les Maîtres fous, où il suit la secte des Haukas, au Niger, dont les cérémonies secrètes élaborent peu à peu un rituel inspiré des manifestations publiques du colonisateur britannique. Reprendre les codes du dominant pour se les approprier et les excéder n’est pas seulement le b-a-ba de la subversion, c’est tout autant une façon de se forger un statut.
La question qui vient juste après est celle qui traverse toute marge : s′agit-il d′en rester à l′espace gagné ou bien d′engager un rapport de force pour s′extraire de la marginalité ? Les deux positions sont incarnées respectivement par Elektra Abundance et Blanca Rodriguez. La première a peu à perdre, puisqu′elle est entretenue par un riche blanc. La seconde, en revanche, se sait contaminée par le Sida. Son combat n′est pas à son bénéfice mais à celui de ceux qu′elle héberge dans sa « maison ».


La rivalité de ces deux « mères » et de leurs « maisons » respectives, s′exprime lors des défis que les « balls » imposent. Elle passe aussi par des discussions acrimonieuses où, par exemple, Elektra compare sa rivale à Rosa Parks. Blanca, en effet, mène sa petite guerre en se faisant systématiquement expulser du même bar gay dont la clientèle bourgeoise ne supporte pas la présence de transgenres jugées grotesques. Pas plus que dans les années 60, les blancs de Montgomery (Alabama) ne supportaient qu’une noire refuse de céder sa place de bus à un blanc. En mettant le doigt sur ce genre de contradictions interne à la communauté gay et en poussant son poulain Damon à devenir un grand danseur, Blanca fait de sa « maison » un outil de combat pour l′émancipation des siens. Noir ou transgenre, même combat ! Plus désabusée, Elektra, au contraire, assume les limites du ghetto mais revendique d′en être la figure de proue. Il vaut mieux est le premier dans son village que le second à Rome, comme professe le dicton.

Les deux rivales, tout comme Pray, le maître de cérémonie des « balls », revendiquent cependant la même mission : sauver les gamins perdus de New York, ceux que leurs familles ont rejeté du fait de leur sexualité et qui passent leurs nuits sur les bancs publics, affamés et désespérés.
Pour raconter tout cela avec finesse et persuasion, pour nous faire profondément aimer des personnages aussi excentriques que tragiques, et faire que nous nous reconnaissions en eux en dépit des années, de la distance, des mœurs et de la culture, Pose peut compter sur des acteurs exceptionnels, majoritairement gays ou transgenres. Elle bénéficie également d’un filmage efficace, sans concession ni esthétisation. Le luxe tapageur et l′immensité des bureaux de la Trump Tower s′oppose à l′exiguïté et pauvreté mal déguisée des « maisons » où logent les vogueurs. Les lumières urbaines nocturnes règnent, dans ce monde de la nuit, mais sans la séduction qu’on leur attache parfois. Tout se concentre sur les « balls » qui ponctuent les épisodes, comme les résolutions des conflits développés dans l′intervalle. Les « balls » disent où nous en sommes de l′intrigue, des rapports entre les uns et les autres. Tout comme, symétriquement, reviennent des plans sur la jetée où l′un des personnages achève la conversation en portant son regard l′immensité de la baie, opposant ainsi à l’exubérance des « balls » le regret sans fin d’une liberté inaccessible.

Le Voguing a été récupéré, bien évidemment, c’est le destin de toute culture populaire, comme le jazz autrefois, comme le graffiti, le rap, le slam, le hip-hop… ** Au tout début des années 90, la chanson et le clip Vogue de Madonna puis le documentaire de Jennie Linvingston, Paris Is Burning, l’ont popularisé, Judith Butler s’en est inspirée pour théoriser dans Bodies that Matter. Après une éclipse, le voguing connut un nouvel engouement et la France vit le phénomène débarquer dans les années 2000, sous l’impulsion de Lasseindra Ninja. Les Inrocks y ont consacré d’ailleurs un article enthousiaste. Libération aussi, il y a quelques années. Désormais donc, le voguing relève de la culture dominante avant-gardiste. Au prix de sa spontanéité et de sa subversivité politique. Prix exigé par une modernité à laquelle rien ne doit échapper, en particulier pas ce qu′elle a préalablement dédaigné.
Pose est un feuilleton américain écrit par Ryan Murphy et diffusée en sur FX (sur Canal + en France). Il est interprété notamment par : MJ Rodriguez, Ryan Jamaal Swain, Dominique Jackson, Indya Moore, Billy Porter, etc.
Notes :
* « Maison », au sens de « maison Chanel » ou maison Dior’
** À l’exception du Musette, sans doute trop français.


Pingback: Waco | les carnets de la télévision
Pingback: Ratched | les carnets de la télévision